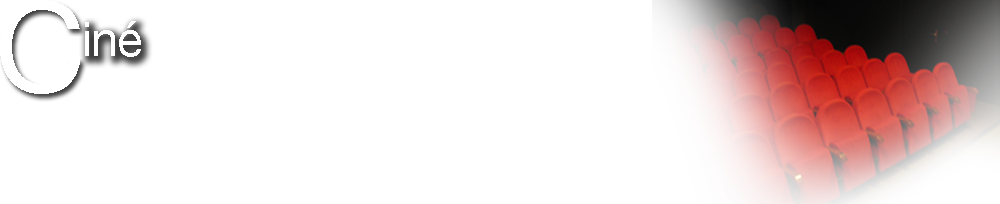Jean-Jacques Sadoux
Quelques réflexions fragmentaires sur une traduction cinématographique
War Party/ She wore a yellow ribbon (La charge héroïque)
Entre 1947 et 1950 John Ford réalise trois films qui constituent une entité originale connue sous le nom de cycle de la cavalerie. Les trois Westerns formant ce triptyque Fort Apache (Le Massacre de Fort Apache, 1947), She Wore a Yellow Ribbon (La Charge Héroïque, 1948), Rio Grande (1950), célèbrent la cavalerie américaine et son rôle dans la conquête de l’Ouest. L’impression d’unité est encore renforcée par le fait que ces œuvres sont la traduction cinématographique de trois nouvelles de James Warner Bellah publiées pour la première fois dans le Saturday Evening Post en 1947 et 1948 : Massacre, War Party et Mission with no record.
Cette trilogie répond à une quinzaine d’années d’intervalle à celle exaltant l’armée britannique aux Indes : Black Watch (1929), Wee Willie Winkie (1937) et Four Men and a Prayer (1938) en utilisant le même type de rituel et Victor Mc Lagen dans les mêmes rôles de sergent fort en gueule mais au cœur d’or.
La collaboration entre John Ford et James Warner Bellah ne devait d’ailleurs pas s’arrêter là puisque c’est à lui que l’on doit le scénario de Sergeant Rutledge (Le Sergent Noir, 1960) qui s’apparente aussi au cycle de la cavalerie par sa célébration sur le mode épique de ces régiments qui devaient assurer la conquête militaire de l’Ouest.
Jean-Loup Bourget rappelle que les films de la trilogie westernienne « sont à la croisée de deux genres, ou constituent si l’on préfère, une hybridation réussie du Western par le film colonial » (1), et il est vrai que la filiation de ces œuvres de Ford avec le cinéma hollywoodien chantre de la grandeur impériale britannique (Les Trois Lanciers du Bengale, Gunga Din, La Charge de la Brigade Légère) apparait dans ces trois Westerns à travers la reprise de schémas narratifs et psychologiques :
« Le héros a le sens de sa responsabilité d’homme blanc civilisé, à l’égard d’indigènes qui sont d’innocents enfants, parfois égarés par d’hypocrites fanatiques. Il est totalement loyal à son « roi et pays », avec un sentiment profond de la camaraderie masculine, « l’esprit de corps » …il ne recherche pas la gloire ou la fortune …ce qu’il craint par-dessus tout est non la mort, mais la lâcheté. » (2)
James Warner Bellah (1899-1976)
Parfois qualifié de « Kipling américain » James Warner Bellah est un écrivain prolifique dont l’œuvre se veut une réflexion sur l’histoire passée et présente des Etats Unis. Issu d’une famille d’ascendance irlandaise qui donna à l’Amérique un grand nombre de juristes et de militaires, l’idéologie qui sous-tend ses récits est très proche de celle d’un Remington (3) ou d’un Teddy Roosevelt (4). La mission civilisatrice de l’homme blanc étant constamment magnifiée et la cavalerie américaine qu’elle soit du Nord ou du Sud célébrée dans un style cocardier dont la nouvelle War Party offre quelques exemples significatifs :
« Fifty cents a day to point the march of empire. Forty men on the rim of a nation, carrying the police power in their carbine boots, with a thousand savage warriors a few miles north of their bivouac.”
She Wore a Yellow Ribbon (La Charge Héroîque) 1949
La traduction cinématographique de Ford porte un titre qui témoigne d’une rupture de ton assez inhabituelle.
La nouvelle de Warner Bellah s’intitule sobrement War Party et le titre que Ford choisit pour son adaptation contraste fortement avec ceux qu’il donne aux deux autres films qui composent la trilogie. Massacre devient Fort Apache (Le Massacre de Fort Apache), et Mission with no Record sera Rio Grande.
Dans les deux cas on constate en dépit de la modification du titre original une volonté de conserver voire d’amplifier l’ancrage dans l’univers du Western.
Avec She Wore a Yellow Ribbon rien de tel, et il est amusant de constater que le titre français La Charge Héroïque cultivant à des fins commerciales un effet de redondance renvoyant à La Chevauchée Fantastique (Stagecoach, 1939) se situe délibérément dans l’esprit westernien le plus classique.
Le titre qu’a choisi Ford est explicité dans les paroles de la chanson qui accompagne le générique :
« Round her neck she wore a yellow ribbon. She wore it in the winter, in the merry month of May, and when I asked her why the yellow ribbon she said: it’s for my lover who’s in the cavalry”
La couleur jaune étant fortement connotée dans l’imaginaire hollywoodien (3) le film aura une tonalité à la fois sentimentale et mélancolique en renvoyant à la tradition américaine du XIXéme siècle qui voulait que les épouses ou fiancées des cavaliers de la US cavalry agitassent ce ruban quand leurs compagnons quittaient le fort.
A la peinture de l’officier vieillissant et bourru que les circonstances amènent à reprendre du service au moment de sa retraite, Ford ajoute en contrepoint des relations amoureuses et l’annonce sans ambiguïté dès le générique.
On trouve également un intéressant terrain de comparaison dans la lecture de la nouvelle de Bellah et du découpage technique de Frank Nugent.
Dans l’édition originale de War Party, publiée le 19 juin 1948 dans le Saturday Evening Post, on trouve sous forme de « chapeau » une phrase qui présente l’œuvre au lecteur, et qui fonctionne en fait comme un pré-générique au cinéma :
“Forty weary cavalrymen were all that lay between the fort and the enemy’s nine hundred – the savage, bloodthirsty WAR PARTY”
Le film quant à lui s’ouvre sur un gros plan du fanion du 7éme régiment de cavalerie, accompagné du commentaire suivant prononcé par une voix off :
« Custer is dead. And around the bloody guidon of the immortal Seventh Cavalry lie two hundred and twelve officers and men.”
S’enchainent alors une série de scènes très brèves évoquant les hommes du Pony Express livrant au péril de leurs vies le courrier à travers l’Ouest, tandis que le commentaire se poursuit :
« The Sioux and Cheyennes are on the warpath. By military telegraph news of the Custer massacre is flashed across the long roamy miles … to the Southwest … and by stagecoach to the hundred settlements and the thousand farms standing under threat of an Indian uprising. Pony Express riders know that one more such defeat as Custer’s, and it would be a hundred years before another wagon train dared to cross the Plains”.
On voit alors une colonne de cavaliers indiens en tenue de guerre traverser l’écran comme empreints d’une sourde détermination, tandis que la voix off conclut :
« And from the Canadian border to the Rio Bravo … ten thousand Indians, Kiowas, Comanches, Arapahoes, Sioux and Apache – under Sitting Bull and Crazy Horse, Gall and Crow King, are uniting in a common war against the United States Cavalry”.
Cette sequence d’ouverture offer une illustration intéressante des propos que John Ford met dans la bouche d’un journaliste dans The Man Who Shot Liberty Valance : « In the West , Sir, when facts conflict with the legend, we print the legend.”
La vérité historique ne préoccupe que modérément John Ford beaucoup plus attaché à la légende qu’à la stricte interprétation des faits. Rappelons en passant qu’en 1876 les cavaliers du Pony Express ne convoyaient plus le courrier depuis longtemps, l’entreprise ayant duré moins de deux ans (1860-1862) et que les Indiens Sioux et Cheyennes, après leur victoire éphémère de Little Big Horn sur la cavalerie américaine, s’étaient soit enfuis au Canada (Sitting Bull), soit rendus aux autorités (Crazy Horse) et ne constituaient nullement une menace pour la colonisation de l’Ouest.
Quant à la prétendue alliance entre Comanches, Sioux et Apaches, elle relève purement et simplement du délire sur le plan historique, ou plus grave encore pour reprendre la formule de Jon Tuska « du « cauchemar racial ».(4)
Cette introduction, qui dans un film plus récent serait utilisée comme pré-générique, est en quelque sorte le pendant des lignes mises en exergue dans la nouvelle de James Warner Bellah. Leur dépouillement et leur sobriété contrastent fortement avec le ton épique adopté par Ford. Il ne s’agit plus ici d’une menace qui pèse sur toute la colonisation de l’Ouest, mais du sort de quarante cavaliers et du fort où ils sont basés.
Ce qui frappe dans l’introduction de la nouvelle, c’est le caractère spectaculaire et la volonté de dramatisation du récit. L’emploi de termes comme « savage » ou « bloodthirsty » anticipe le style du commentaire dit par la voix off. Il s’opère néanmoins dans la traduction cinématographique un glissement significatif vers une présentation moins connotée sur le plan racial. La violence et le parti pris dont témoigne l’œuvre de James Warner Bellah ne pouvaient passer telles quelles à l’écran dans un cinéma encore fortement encadré par le Code de Production mettant en garde, officiellement du moins, contre tout langage cinématographique susceptible d’encourager la haine raciale.
Les exemples sont nombreux dans War Party de cette vision raciste de l’Indien, et de cette peur de la miscegenation qui hante tout un courant de la littérature américaine, de The Last of the Mohicans de Fenimore Cooper au Clansman de Thomas Dixon.
Quelle que soit la crainte qu’inspire l’Indien, on ne retrouve à aucun moment dans le film de Ford des passages comparables à ceux qui parsèment le texte original :
« Dead soldiers, bloating and bursting their filthy shirts along the lone miles of the prairie. Scalped settlers and mutilated women and half-breeds born of white girls”.
Dan Ford dans Pappy: The Life of John Ford fait d’ailleurs remarquer que les nouvelles de James Warner Bellah se déroulant à Fort Starke : « are heavy on rape and racism, and their message about the Indians is clear: the only good one is a dead one”. (5)
Les impératifs du Code de Production ne suffisent pas à expliquer la différence de ton entre la nouvelle War Party et le film She Wore a Yellow Ribbon. Cette différence provient essentiellement de l’humanisme et l’absence de préjugés de John Ford qui se manifestent non seulement à travers ses œuvres mais aussi dans ses déclarations publiques. Dans Amis Américains , passionnant recueil d’entretiens avec les grands auteurs d’Hollywood, Bertrand Tavernier rappelle la position du cinéaste sur le problème racial aux Etats Unis :
« Je suis un homme du Nord. Je déteste la ségrégation …J’ai obligé une compagnie de production à payer une tribu d’Indiens qui étaient dans la misère selon le tarif des figurants d’Hollywood les plus payés et je les ai sauvés. Raciste, moi ? Mes meilleurs amis sont des noirs …Je considère les Noirs comme des Américains à part entière. » (6))
Parlant de son dernier Western Cheyenne Autumn (1964) Ford déclarait :
« I had wanted to make it for a long time. I’ve killed more Indians than Custer, Beecher and Chivington put together. There are two sides to every story, but I wanted to show their point of view for a change…Let’s face it; we’ve treated them very badly. It’s a blot on our shield, we’ve cheated and robbed, murdered, massacred and everything else, but they kill one white man and God, out come the troops”. (7)
A l’époque de la réalisation de She Wore a Yellow Ribbon Ford était encore prisonnier d’un certain type de préjugés qui peuvent laisser croire au spectateur d’aujourd’hui qu’il avait une interprétation raciste de l’histoire de l’Ouest. La vision du premier volet de la trilogie Fort Apache montre à quel point il pouvait être imprévisible et passer du révisionnisme le plus affirmé à un relatif conformisme.
***
Le passage où Nathan Brittles se rend au cimetière semble avoir été écrit par James Warner Bellah en pensant à une adaptation éventuelle de sa nouvelle par John Ford.
En effet s’il y a une scène éminemment fordienne, c’est bien celle du héros venu se recueillir sur la tombe d’un être cher. De Judge Priest (1934) à My Darling Clementine (1946) en passant par Young Mister Lincoln (1939), cette séquence récurrente témoigne de l’importance chez Ford des liens unissant l’homme à la cellule familiale et à la terre qui la porte.
C’est pourtant dans une scène semblable, où l’osmose entre le film et le texte devrait être presque parfaite que s’opère un divorce permettant de saisir l’originalité de la démarche créatrice chez John Ford.
Situées toutes deux au début du récit, d’une durée à peu près analogue dans le contexte de l’œuvre (38 lignes et 3’ 10’’), les « mises en scène » de cet instant fugitif différent radicalement dans leur atmosphère et leur signification profonde.
Tout d’abord le moment de la journée n’est pas le même : à la chaleur accablante du soleil à son zénith de la nouvelle succède les lueurs mordorées du crépuscule du film.
James Warner Bellah n’a pas choisi midi par hasard : il y a un lien lourdement suggéré entre la chaleur brulante du soleil et la fièvre qui devait emporter sa femme et ses enfants (« The noon heat was the red fever of small-pox again – the blasphemous fire in a soul that would not accept ».)
Peut-être y-a-t-il aussi un rappel involontaire et diffus de la valeur symbolique de midi :
« Midi marque une sorte d’instant sacré, un arrêt dans le mouvement cyclique, avant que se rompe un fragile équilibre et que la lumière bascule vers son déclin. Il suggère une immobilisation de la lumière dans sa course – le seul moment sans ombre – une image d’éternité ». (8)
Sur le point de prendre une décision capitale, à la ligne de démarcation entre le monde du service actif et celui de la retraite, Brittles vient se recueillir dans le dépouillement aveuglant du soleil de midi. (9)
Le choix du crépuscule chez Ford pour représenter la même scène n’est certainement pas fortuit non plus.
Il lui permet tout d’abord de travailler la couleur et la plastique de l’image en situant cette séquence au moment où les ombres s’allongent et où les teintes du soleil couchant adoucissent le paysage. La brutalité de la lumière de midi aurait été parfaitement incongrue pour traduire l’atmosphère élégiaque voulue par le cinéaste.
Le caractère d’enluminure naïve, de moralité de She Wore a Yellow Ribbon trouve dans ce choix du crépuscule qui « exprime la fin d’un cycle et en conséquence la préparation d’un renouveau » (10), le moment idéal pour une méditation sur la mort de Custer et du fringant officier irlandais (11) qui faisait valser Mary, l’épouse de Brittles, ainsi que l’annonce du son départ vers l’Ouest et la promesse de vie que porte en elle la jeune Olivia.
Le second point qui témoigne d’une rupture entre le texte et le film est la structure même de la scène.
Construite sur un retour en arrière dans la nouvelle de Bellah, elle nous présente un personnage muet qui se trouve presque malgré lui placé devant la tombe des siens et qui revit les moments de souffrance et d’égarement qui ont marqué cette période de sa vie. Il y a chez le Nathan Brittles imaginé par James Warner Bellah une dureté, un refus total de tout sentimentalisme, un désir de refouler cet épisode tragique au plus profond de lui qui en font un personnage bien éloigné de l’univers du cinéaste : That kind of sentiment was not in him » (12)est une notation totalement étrangère à la psychologie du héros fordien, que ce soit le Wyatt Earp de My Darling Clementine, l’Abraham Lincoln de Young Mister Lincoln ou le capitaine Brittles de She Wore a Yellow Ribbon.
***
La scène du cimetière dans la nouvelle de James Warner Bellah est précédée d’une entrevue avec le major Allshard commandant du fort. She Wore a Yellow Ribbon reprend cet enchainement mais en lui donnant une toute autre signification.
Dans War Party, Brittles se rend chez le major dans le secret espoir d’apprendre que le ministère de la guerre lui a confié le poste d’éclaireur qu’il a sollicité, d’où son amertume lorsqu’il est informé que sa demande n’a pas été prise en considération (« For the first time in his life he felt old and not wanted ») ; ce ne sont pas les bonnes paroles de son supérieur ( « I want you to know Brittles that it has been a privilege to serve with you ») qui atténuent sa déception, d’autant que la dernière mission qu’il souhaiterait remplir, prêter main forte au détachement de Cohil menacé par les Comanches, ne lui est pas proposé (« He wanted desperately to have Allshard give him the official word on Cohil ».)
C’est donc un homme amer et désabusé qui quitte le bureau du major et passe devant le cimetière du fort. Les deux scènes nous présentent un personnage profondément marqué par un passé qu’il revendique et repousse à la fois, et qui se sent impuissant devant un avenir sur lequel il n’a aucune prise.
John Ford reprend le canevas initial mais souligne davantage le lien entre les deux scènes en les enchâssant dans une sorte de cadre constitué par des sonneries exécutées par deux clairons, au début et à la fin de cette double séquence, le premier tourné vers la droite, le second vers la gauche.
Cet artifice de mise en scène fait bien ressortir l’unité interne des deux scènes, impression qui sera encore renforcée par l’évocation de Miles Keogh. En effet la scène chez le major nous montre celui-ci donner lecture à Brittles de la dépêche les informant de la défaite de Custer sur le Little Big Horn et lui remettant la liste des victimes. En arrivant au nom de Keogh, Brittles marque un temps d’arrêt suivi d’un fondu enchainé qui introduit la scène du cimetière.
Alors que la nouvelle évoque avec une grande sécheresse ce moment privilégié où Nathan Brittles se révèle un être vulnérable, la traduction cinématographique donne à cette scène une densité dramatique exceptionnelle en combinant subtilement le mélange des genres : l’émotion fait place à l’humour lorsque Brittles évoque sa jalousie passée et ses piètres talents de danseur (« You remember Miles-happy-go-lucky Irishman. He used to waltz so well with you. Well, you know –I guess I was a little jealous. Never could waltz myself …”), puis à son tour au fantastique quand l’ombre d’Olivia qui vient d’arriver se profile sur la pierre tombale et la scène se termine dans une tonalité discrétement mélancolique où se mèle l’évocation du passé et du présent (les deux jeunes lieutenants courtisant Olivia renvoyant au Miles Keogh qui faisait valser Mary Brittles).
… Le passé du capitaine Brittles est beaucoup plus présent dans la nouvelle que dans le film. Le récit de James Warner Bellah en dépit de sa brièveté abonde en références à la carrière militaire de l’officier…
…Située au tout début de la nouvelle (onzième paragraphe), une autre scène importante est reprise intégralement et presque textuellement dans la traduction cinématographique : celle où le capitaine Brittles reçoit de ses hommes comme cadeau d’adieu une montre en argent.
Cela dit, une fois de plus la scène acquiert une toute autre dimension dans sa version fordienne.
James Warner Bellah la situe lors de la première revue de troupes de Brittle lorsqu’il prend son service de bonne heure le matin, Ford lui la fait figurer vers la fin du film après le retour d’une mission infructueuse au fort.
A ce moment-là le spectateur a appris beaucoup sur Brittle, sur ce mélange de rudesse bougonne et de sentimentalisme à fleur de peau qui caractérise le vieil officier. La scène de la remise du cadeau va venir apporter une touche supplémentaire à ce portrait et combler l’attente du spectateur pour qui Ford a savamment amené et préparé ce nouveau temps fort d’un rituel amorcé dès la première scène du film avec le sergent Qincannon.
Rien de tel chez Bellah où la scène frappe par son aspect à la fois conventionnel et laborieux, la description de l’émotion rentrée de Brittle nous laissant parfaitement froid tant le personnage reste distant car à peine ébauché.
Une fois de plus la « Ford Touch », ce subtil mélange des genres, cette façon de faire alterner émotion et humour, va transformer une scène issue de l’imagerie militaire la plus stéréotypée et lui donner une résonance infiniment plus profonde…
***
… Dès le début de War Party (6éme et 7éme paragraphe), les quarante-trois années de service du capitaine sont évoquées par un retour en arrière jusqu’en 1836 lorsqu’il participa à la campagne contre les Séminoles, puis à la guerre du Mexique sous les ordres du général Scott et à la guerre de Sécession de Bull Run à Appomatox avec Phil Sheridan.
Un peu plus loin, lorsqu’il va se recueillir sur la tombe de sa femme et de ses enfants Bellah nous révèle les circonstances du drame et les conséquences qu’il allait avoir sur la carrière militaire de Brittles qui échappant de peu à la radiation perdit toute chance de promotion.
Ce passé militaire de son héros est aussi évoqué pour justifier sa décision de ne pas retourner vers l’est pour sa retraite, mais de poursuivre sa destinée en direction de l’ouest ( Except for Seminole campaign in ’36 and the War, he’d been moving westward all his life »)
Quand il trie les affaires et les effets personnels qu’il a accumulés au fil des ans dans sa vieille cantine, le passé remonte avec des effluves baudelairiennes de « vieux boudoir plein de roses fanées », mais ce sont les souvenirs d’une vie vouée à la cavalerie et le portrait dédicacé du général Scott qui semblent le plus important dans cet inventaire quelque peu surréaliste.
A trop vouloir rappeler les événements et les rencontres qui ont jalonné l’existence de Nathan Brittles, l’auteur fait de lui une représentation désincarnée de l’histoire militaire des Etats Unis, un personnage qui se veut la mémoire vivante d’une époque et d’une institution, mais qui ne parvient jamais à dépasser le stade du cliché.
… Le monologue intérieur de la nouvelle, ou plus exactement la résurgence brutale de souvenirs enfouis dans la mémoire, fait place dans le film à un soliloque qui est en fait un dialogue suspendu laissant imaginer les questions ou les commentaires de l’épouse défunte.
Brittles dans le récit de Bellah reste de l’autre côté de la barrière lorsqu’il observe les tombes des siens, la barrière matérielle évoquant son refus de tout sentimentalisme, son incapacité à s’approcher de trop près de ce passé qui l’écrase.
John Ford met Brittles en contact même avec la tombe de son épouse, il apporte un siège pliant pour s’installer à ses côtés et mieux lui faire la chronique de la vie au fort. Il vient arroser les fleurs qu’il a placées sur la tombe, et cette eau qu’il déverse c’est le lien qui le relie à elle, une façon de nier la mort et d’entretenir le souvenir.
L’officier chez Ford ne veut pas oublier alors que dans la nouvelle il cherche la paix dans l’oubli.
… Les touches humoristiques sont particulièrement rares dans le récit de James Warner Bellah, on pourrait citer tout au plus les quelques allusions à l’âge de Joker le cheval de Brittles : « Joker is old enough to vote this year, sergeant. »
De toute évidence ce n’est pas un registre où Bellah se sente à l’aise, sa célébration de l’héroïsme et de l’abnégation militaire ne s’accommode pas comme chez Ford d’un rappel ironique des petits ridicules des âmes bien trempées.
Cette présence constante de l’humour dans l’adaptation fordienne renforce contre toute attente le caractère élégiaque de ce film nonchalant. Brittles est d’autant plus émouvant qu’il prête parfois à rire par sa raideur et ses maladresses de vieux soldat.
C’est précisément ce gout de Ford pour un certain rituel comique qui lui a attiré à propos de ce film les foudres du scénariste Nunnaly Hohnson. Dans une lettre adressée à Linsay Anderson (juin 1950) il qualifie le scénario pour ce film de Frank Nugent et Laurence Stalling de : « Trashy script from two writers who were little more than amenuenses » (12) Il estime que Ford porte l’entière responsabilité de ce ratage (« The blame for such a picture I put on Ford … heassumes responsibility for everything about it ». Ce qui motive son rejet c’est apparemment les facéties de Victor Mc Lagen et les plaisanteries éculées sur les sergents irlandais de la cavalerie américaine : « I am tired of Victor Mc Lagen stealing slugs of whisky and then bellowing at a line of soldiers who give him the bird behind his back ». (13)
Le point de vue de Nunnally Johnson est très voisin de celui de Jean Mitry qui ramène La Charge Héroïque à la dimension « d’agréable imagerie d’Epinal », et voit dans ce film un exercice de style quelque peu factice et répétitif. (14)
Il est frappant de constater que Jean Mitry pour qui ce film ne serait qu’une illustration de thèmes récurrents des westerns de série, ne mentionne jamais qu’il s’agit de la traduction cinématographique d’une nouvelle de Warner Bellah, et qu’à aucun moment il n’envisage d’étudier le travail de relecture entrepris par Ford et ses scénaristes.
On se rend compte en lisant ces commentaires acerbes ou blasés sur ce film à quel point ils se situent dans une tradition qui peut être qualifiée de politiquement correcte tant elle procède d’une vision superficielle et convenue de l’œuvre de Ford.
Bertrand Tavernier cinéaste rigoureux et exigeant doublé d’un homme à l’immense culture cinématographique et littéraire qualifiait She Wore a Yellow Ribbon de « déchirante ballade crépusculaire » (15), gageons que c’est ce que la postérité retiendra de cette œuvre magistrale quand elle aura oublié depuis longtemps la nouvelle de James Warner Bellah qui l’a inspiré.
Jean-Jacques Sadoux
Notes
(1) Jean-Loup Bourget, John Ford Rivages/Cinéma, 1990, page 32
(2) Jean-Loup Bourget, Hollywood, années 30, du krach à Pearl Harbor, 5 Continents, Hatier, 1986, page 66
(3) Michel Cieutat, Les Grands Thèmes du Cinéma Américain, 328-330, tome 2.
(4) Jon Tuska, The American West in Films (page 64)
(5) Dan Ford Pappy: The Life of John Ford, Prentice-Hall, 1979, (page 214)
(6) Bertrand Tavernier, Amis Américains, Institut Lumière/Actes Sud, 1993,page 79
(7) Native Americans.co.UK Film review Cheyenne Autumn
(8) Dictionnaire des Symboles, page 632
(9) Midi est une heure fatidique dans la mythologie du Western littéraire et cinématographique: qu’on se souvienne de la nouvelle de Stephen Crane Twelve o’clock ou du film de Fred Zineman High Noon (Le Train Sifflera Trois Fois)
(10) Dictionnaire des Symboles, page 311
(11) Cet officier, le capitaine Myles W. Keogh figure effectivement dans la liste des pertes américaines à la bataille de Little Big Horn (cité dans Custer’s Fall de David Humphrey Miller, page 206).Irlandais d’origine, soldat de fortune, ancien membre de la garde papale, il eut une conduite exemplaire pendant la Guerre de Sécession.
(12) Amenuensis : a person employed to write or type what another dictates (secrétaire, adjoint, assistant)
(13) Lindsay Anderson, About John Ford, page 247
(14) Jean Mitry, John Ford, page 139
(15) Bertrand Tavernier et Jean-Pierre Coursodon, 50 ans de Cinéma Américain ,Nathan, 1991, tome 1 ,page 461.